
Un moment de bonheur
Loin des pilosités obscènes de L’Origine du monde, des soupçons de pique-nique fornicateur des Demoiselles du bord de Seine, des fantasmes inavouables sur les fillettes enfilant leurs bas blancs ; loin des paysans au faciès de quarante-huitards semblant enterrer à Ornans la république sociale après la fermeture des Ateliers nationaux, loin enfin des femmes damnées goûtant aux amours saphiques, Les Baigneuses de Courbet semble une image bien innocente : une femme, sans doute de condition modeste, sort de l’eau claire d’une source ; sa servante, voulant se tremper à son tour, a commencé à retirer ses bas mais elle est interrompue par le retour de sa maitresse et se précipite pour lui tendre ses vêtements. Par un geste impérieux, celle-ci semble lui dire qu’elle se débrouillera bien toute seule et qu’elle peut aller se baigner. Le charme du tableau tient dans les gestes insolites ; non pas les poses extatiques des nymphes sortant de l’eau mais des instantanés de la vie de tous les jours (la photo, qui fait son apparition, suscite un vif intérêt chez les artiste réalistes). Du plaisir simple, de bon aloi, entre femmes du peuple, si proches l’une de l’autre, même si l’une est la bonne et l’autre la maîtresse. Des arbres au feuillage épais protègent leur tranquillité. Le sourire de la servante illumine le tableau au milieu de cette nature, riante elle aussi. Moment de douceur volé à un quotidien besogneux. Par cette atmosphère d’abandon, le tableau préfigure ce que sera vingt ans plus tard la peinture impressionniste : la représentation d’un pur instant de bonheur partagé au sein d’une nature foisonnante. Les couleurs sont encore sombres, mais il y a de la lumière et la végétation est profonde et poétique.
Mais alors pourquoi le coup de cravache de Napoléon III ce 14 mai 1853, veille de l’inauguration du Salon ? Allez-y rien comprendre.
La révolution réaliste
Revenons sur les faits. Lorsqu’à vingt ans Courbet, issu d’un milieu de propriétaires terriens aisés, quitte sa Franche-Comté natale avec la ferme intention de se faire un nom, il arrive dans la capitale à une époque où l’art est séparé de la réalité. Les tenants du néoclassicisme, avec Ingres pour chef de file, reproduisent inlassablement les sujets mythologiques et historiques. Quant aux Romantiques, dominés par Delacroix, ils cherchent maintenant leur inspiration du côté de l’Orient, pratiquant ce que les Anglais appellent escapisme, sorte de refus de se confronter à la société, après les désillusions des révolutions manquées. Refusant les canons du beau académique et la fuite vers les mirages de l’Orient, Courbet prend le parti de la réalité, moins par école que par tempérament, considérant le monde extérieur comme la matière même de l’art, et défendant le caractère objectif de la représentation. Il le prouvera par ses travaux de jeunesse. En effet, après trois autoportraits qui cultivent la veine romantique de l’homme blessé et désillusionné, il liquide le désespoir et s’intéresse dorénavant au monde qui l’entoure : en 1849 il peint coup sur coup L’ Après-dîner à Ornans, Un Enterrement à Ornans, Les Casseurs de pierres. Comme Victor Hugo à la même époque pour la littérature, il fait entrer le peuple dans la peinture. Ce peuple qui fait si peur depuis les journées sanglantes de Juin 48. Le peindre, c’est déjà se compromettre. Courbet est le témoin et peut-être même l’acteur d’un clivage qui n’arrêtera désormais plus de structurer la société française et qui oppose la gauche de la gauche aux républicains prêts à s’agenouiller devant l’homme providentiel (ce sera chose faite le 2 décembre 1851), les uns ayant une foi robuste dans le matérialisme, qui est l’affirmation de la réalité, les autres se réfugiant dans l’idéalisation qui est la négation de la réalité.
Même s’il est exagéré et injuste de prétendre que l’œuvre de Courbet est une profession de foi socialiste, c’est ainsi qu’on la reçut unanimement, et on le lui fit payer cher. Peu de peintres eurent à affronter tant de haine et d’incompréhension pour avoir représenté le prosaïsme de la vie quotidienne. Rarement enjeux esthétiques et politiques furent aussi liés. Mais le gaillard était solide : sûr de son bon droit, il avait jeté un pavé dans la mare, et la violence des réactions que ses tableaux suscitèrent est à la mesure de la révolution qu’il apportait dans la peinture et dans les esprits.
Un succès de scandale
A une époque où les galeries n’existent pas, le seul moyen de se faire connaître est d’exposer ses œuvres aux Salon qui se tiennent chaque année. Encore faut-il que le tableau soit accepté, et la partie n’est pas gagnée. L’ empereur, ce rêveur équivoque, n’aime en peinture que les femmes descendues de l’Olympe, que lui servent sur un plateau d’argent les peintres courtisans. Nues et libidineuses à souhait pour mettre en émoi les bourgeois, mais bien propres pour ne pas les effrayer. Finalement le tableau et accepté, mais Courbet sait bien que sa baigneuse n’a rien à voir avec les nus académiques d’Ingres. Quelques jours avant l’exposition, pour estomper l’effet désastreux que pourrait avoir une nudité crue, il avait ajouté en toute hâte un linge sur le beau séant de la baigneuse.
Peine perdue : le jour de la présentation au couple impérial, l’impératrice, qui vient d’admirer un tableau de Rosa Bonheur représentant un marché aux chevaux percherons, se trouve subitement face au tableau de Courbet et s’écrie « Et maintenant voici la percheronne !», tandis que son époux cingle d’un coup de cravache la lourde chute de rein. Le tableau fait scandale : ce corps musculeux façonné par un vie de labeur ne passe pas, et les courtisans, Prosper Mérimée en tête, prêtent main forte à l’empereur en organisant la curée: « Figurez-vous une sorte de Vénus Hottentote sortant de l’eau et tournant vers le spectateur une croupe monstrueuse et capitonnée de fossettes au fond desquelles ne manque que le macaron de passementerie » ; ou encore : « Je ne saurais m’expliquer comment un homme se serait complu à copier au naturel un vilaine femme avec sa bonne, qui prennent dans une mare un bain qui leur semble être fort nécessaire » ( cité par Louis Aragon).
Les enjeux du réalisme
Copier au naturel, voilà bien l’infamie dont Courbet s’est rendu coupable. Mais les reproches qui lui sont faits d’avoir dérogé aux règles du beau académique ne sont que de mise. Son véritable crime, c’est d’avoir montré le peuple dans toute sa franchise. C’est d’avoir encanaillé l’art.
Pourtant Courbet a peint toutes sortes de scènes qui n’ont rien à voir avec le peuple, à moins bien-entendu de soupçonner que La remise des Chevreuils soit une réunion de conspirateurs républicains dans la forêt ou que l’Hallali du cerf soit l’allégorie à peine voilée de Napoléon III martyrisant le peuple avec son fouet ! Beaucoup étaient prêts à faire l’amalgame. La vérité est que Courbet était un peintre animalier hors pair, et sa fibre naturaliste le portait à ouvrir ses yeux sur le monde. Il a peint aussi de merveilleux paysages francs-comtois. Que de haine ne s’est-il pas alors attirés de son faux ami Baudelaire qui répétait à l’envi « la nature est laide ». Au nom de la condamnation de la nature, le chef de file du dandysme n’eut pas de mots assez durs contre l’auteur des Baigneuses, préférant se prosterner devant La Fontaine de Jouvence de William Hausselier que tout le monde a oublié. La nature est laide ? Allez dire à Manet, à Monet, à Sisley, à Renoir que la nature est laide ! Tous ont en commun de s’être engouffrés dans la brèche ouverte par Courbet, leur vision procédant directement de lui, qui avait affirmé haut et fort la contemporanéité de l’art, le primat de la matière sur la forme et… l’existence du monde extérieur !
Le procès du réalisme est un procès sans fin. Manet le vivra dix ans plus tard avec l’insolente Olympia, la Vénus des bordels parisiens qui, servit à la jeune école de manifeste et de contre modèle critique aux Vénus des Cabanel et autres peintres académiques, pour qui l’art se devait d’être beau et agréable envers et contre tout. Il subit le même procès en vulgarité. Derrière la haine du réalisme s’exprimait, encore et toujours la haine du peuple et, de fil en aiguille, du socialisme naissant.
Un siècle après Les Baigneuses, il se trouvait encore des esprits chagrins pour penser que montrer le peuple, c’est attenter à l’ordre public. En 1951, le préfet de police Baylot faisait décrocher les toiles de sept peintres au Salon d’automne consacré au nouveau réalisme. Mais les mœurs ont changé : de nos jours la police ne s’avise pas d’aller décrocher les tableaux dérangeants, pas même L’Origine du monde. Il est toutefois dommage que ce trou noir détourne le regard des foules des autres œuvres de l’artiste, comme on a pu le constater dans la dernière grande exposition consacrée à Courbet. Fort heureusement, la toile est désormais à Ornans. Ce retour aux origines nous délivrera peut-être d’un malentendu sur les enjeux véritables du réalisme chez Courbet.
Louis Dizier


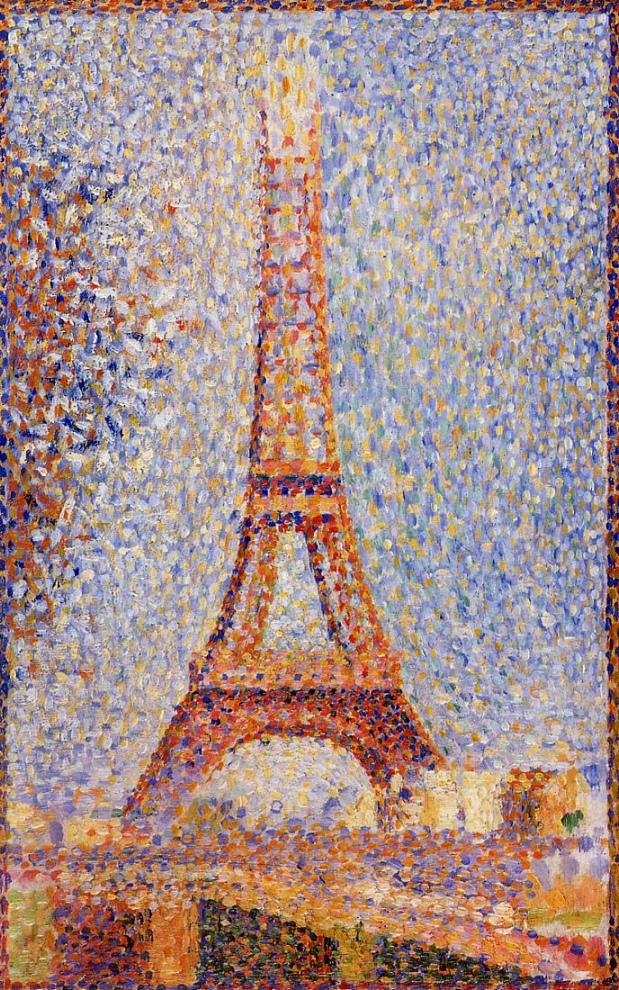 Un OVNI dans le ciel parisien
Un OVNI dans le ciel parisien