Par Louis Dizier
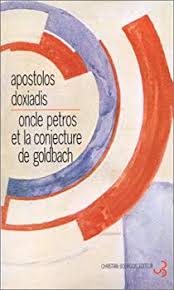
Apostolos Doxiadis Oncle Petros et la conjecture de Goldbach,
Christian Bourgois éditeur, 1999
Souvent, chez l’homme de science, l’exploration se confond avec le sentiment du poète. En atteste le beau livre d’Apostolos Doxiadis qui nous invite à un voyage dans la galaxie des nombres premiers. Ceux-ci ne sont pas seulement les éléments de base des nombres entiers, ils sont la materia prima de l’univers mathématique. Mais comment admettre que leur succession ne soit déterminée par aucune loi ? L’absence apparente de tout principe infaillible pour leur distribution ou leur succession tourmente les mathématiciens depuis des siècles et rend particulièrement fascinante la théorie des nombres.
les nombres premiers fascinent parce qu’il n’existe aucune distribution régulière, aucun procédé par lequel on part d’un nombre premier pour aboutir au suivant, parce qu’ils sont un infini non prévisible, contrairement à la suite des nombres entiers, parce qu’il est très difficile, au-delà d’un certain seuil, de savoir si un nombre est premier ou non, de trouver le moyen de calculer combien il y a de nombres premiers inférieurs à un nombre donné n, parce que certains ont des propriétés insolites et aussi parce qu’ils sont utilisés dans le cryptage des messages secrets. Bref, ils sont souvent qualifiés de mystérieux dans les fantasmes et les rêveries des mathématiciens poètes, à l’instar du « Geheimnisvolle » d’Einstein. D’aucuns aimeraient voir dans les nombres premiers une galaxie pleine de trous noirs et de naines blanches, plutôt qu’un morne désert de Gobi avec de temps un caillou un peu plus lisse et poli que les autres.
Le narrateur utilise un procédè assez classique en littérature ( et au cinéma) qui consiste à incruster un personnage imaginaire dans une histoire bien réelle au milieu de personnages qui ont bien existé. Il nous livre une étonnante biographie de son oncle Petros Papachristos ( personnage fictif), enfant prodige, né en 1895 dans une famille d’entrepreneurs athéniens.
Pour le jeune homme, un mathématicien moyen est une tragédie ambulante. Il veut laisser à la postérité une empreinte égale à ceux dont on a érigé une statue dans l’empyrée mathématique, les Thalès, les Euclide, les Newton, les Galois. Il redoute par-dessus tout que son nom soit signalé à la postérité par une note en bas de page, comme tant d’autres qui furent pourtant en leur temps de brillants mathématiciens. La médaille Fields d’argent, ça n’existe pas. En mathématiques il n’y a de place que pour la lumière ou la nuit.
Comment devient-on un grand mathématicien ? C’est simple, il suffit de résoudre un grand problème mathématique. Or, en ce début de vingtième siècle, trois d’entre eux restent en suspens : l’hypothèse de Riemann, le dernier théorème de Fermat et la conjecture de Goldbach. Son choix se portera sur le troisième. Cette conjecture, on la trouve formulée pour la première fois en 1742 dans une lettre que le mathématicien allemand Christian Goldbach adresse à son collègue suisse Leonhard Euler. Selon lui, tout nombre entier pair supérieur à deux est la somme de deux nombres premiers : 4=2+2, 6=3+3, 8=5+3, 10=5+5 etc. Mais encore faut-il le prouver. Euclide ayant déjà donné la preuve au 3ème siècle avant JC que les nombres premiers sont à l’infini, il est impossible de procéder au cas par cas.
Voilà donc le jeune homme introduit au Trinity College de Cambridge auprès de trois grands spécialistes de la théorie des nombres, les Anglais Hardy et Littelwood, et l’Indien Srinavasa Ramunujan. Pour les deux premiers, il va de soi que la conjecture de Goldbach s’applique à l’infini, mais le chercheur indien instille le doute : selon lui, elle est probablement inapplicable pour des nombres très élevés. Il n’en faut pas plus à Petros Papachristos pour tenter de faire rendre gorge à cette énigme. Il lui consacrera toute sa vie.
Commence alors pour lui l’exploration de l’insondable mystère des nombres premiers. Beaucoup d’entre eux ne sont séparés que par un entier : 5 et 7, 11 et 13, 41 et 43, 9857 et 9859 et ainsi de suite, la plus grande valeur connue étant à ce jour 835 33539014 +/-1. Mais il arrive parfois que deux nombres premiers consécutifs soient séparés par des millions d’entiers non premiers. Allez-y rien comprendre…
Convaincu qu’en mathématiques il n’y a pas de place pour les ignorabimus, Petros mène désormais la vie repliée des savants austères, fuyant ses collègues et se coupant progressivement de toute vie sociale. Il s’aide d’abord de la méthode analytique développée par les mathématiciens français Hadamard et La Vallée-Poussin. Mais il finit par lui tourner le dos, la qualifiant de méthode à la mode (car en mathématiques, comme partout, il y a des modes). Il lui préfère la méthode géométrique, plus traditionnelle. Des années durant, il disposera inlassablement des quantités phénoménales de haricots secs sur le plancher de sa chambre, tantôt en rectangles de deux colonnes pour les nombres pairs, de plusieurs rangées et colonnes pour les nombres impairs, tantôt en une seule rangée pour les nombres premiers. Mais là encore la méthode se révélera infructueuse, et les haricots termineront en cassoulet.
Sans trouver le Saint Graal, Petros fait toutefois des avancées notables, mettant au point des résultats intermédiaires, notamment le théorème des partitions. Pas de quoi pavaner pour autant, tant que le problème initial n’a pas été résolu : ce qui compte, c’est le but ultime…Il se garde bien de publier ses résultats pour ne pas mettre le pied à l’étrier à un potentiel rival. Mal lui en prend : un mathématicien autrichien le coiffe sur le poteau en publiant avant lui son théorème. S’étant coupé de la communauté des chercheurs, Petros n’avait pas vu venir le danger.
Cette première déconvenue amorce un long déclin. Petros sait que le temps lui est compté. En mathématiques comme en sport, il faut être jeune pour réussir. Le temps, qui détruit la vigueur de l’esprit autant que celle du corps, est un ennemi redoutable.
Il retrouve un calme relatif en pratiquant le jeu d’échecs mais ne s’avoue pas pour autant vaincu. On n’abandonne pas si facilement ses amis les nombres. Au fil des ans, il a développé une familiarité certaine avec eux, connaissant leurs particularités, bizarreries et anomalies. 13 est une espèce de gnome bondissant aux allures de farfadet, tandis que 8191 se présente sous les traits d’un gavroche parisien avec son mégot planté au coin des lèvres. Mais les nombres non premiers sont en embuscade : 333 lui apparaît souvent comme un gros bonhomme malpropre, tandis que presque toutes les nuits le couple diabolique de 2100 (c’est-à-dire 299 et 299) fait son apparition, se présentant sous les traits de deux ravissantes jumelles monozygotes à taches de rousseur et à prunelles sombres peuplant ses rêves de funestes présages.
En effet, un cancer moral ronge Petros de l’intérieur. Jusqu’à présent, il croyait dur comme fer à la notion de complétude des théories mathématiques, selon laquelle toute proposition juste est démontrable ; cette notion n’était pas prouvée, mais personne ne doutait qu’on y parviendrait un jour. Mais voici qu’un beau jour un étudiant surdoué, Alan Turing, lui apprend que le mathématicien autrichien Kurt Gödel (dont Petros connaissait vaguement le nom) a prouvé le contraire : les théories mathématiques ne sont pas complètes. Autrement dit, quels que soient les axiomes admis, toute théorie des nombres contiendra obligatoirement des propositions indécidables, exactes mais impossibles à prouver. A ce moment le sol se dérobe sous les pieds de Petros. Le théorème de l’incomplétude de Gödel met fin à ses propres certitudes : il n’y a pas d’ignorabimus en mathématiques. Pire encore : et si le théorème de l’incomplétude s’appliquait à son propre problème ? La conjecture de Goldbach serait-elle indémontrable ? Petros veut en avoir le cœur net et fait le voyage pour rencontrer Gödel afin de lui poser la question qui le taraude : existait-il un moyen de déterminer si son théorème s’appliquait à une hypothèse donnée ? La réponse de Gödel lui glace le sang : on ne peut déterminer a priori quelles propositions sont démontrables et lesquelles sont indémontrables. Toute proposition non démontrée peut être indécidable.
Autrement dit, le théorème de Gödel n’a pas valeur de couperet, mais de menace imprécise. Aussi longtemps que le problème n’était pas démontré, il n’existait aucun moyen de savoir si la démonstration était irréalisable ou simplement très difficile. Alan Turing le prouvera d’ailleurs par la suite.
Suite à ces révélations, l’état mental de Petros se dégrade peu à peu. Titulaire d’une chaire de mathématiques à l’université de Munich, il est obligé de rentrer en Grèce en 1940 lorsque les puissances de l’Axe entrent en guerre contre son pays. Il abandonne toute recherche et termine sa vie dans une maison de campagne de la région d’Athènes, occupant ses journées à des travaux de jardinage.
Cette déchéance suscite des interrogations et des réprobations. Dans le cercle familial, Petros est désigné comme l’exemple à ne pas suivre. Pour le père du narrateur, c’est un raté qui n’a pas compris que « le secret de la vie, c’est de se fixer des buts accessibles ». Dans la communauté scientifique, des soupçons naissent : Petros a imputé son désastre à l’incomplétude mathématique qui aurait rendu la conjecture de Goldbach impossible à prouver. Mais jamais aucun mathématicien auparavant n’avait sérieusement attribué son échec à une démonstration du théorème de l’incomplétude. L’excuse est un peu facile, ces raisins sont trop verts. Pour beaucoup, Petros avait surestimé ses capacités, et la notion d’indécidabilité n’était qu’une supercherie pour excuser sa débâcle.
Le narrateur, plus enclin à la tendresse vis-à-vis de son oncle (même s’il lui était arrivé de le haïr) opte pour une hypothèse métaphysique : l’incompétence, la fatigue et le désenchantement n’auraient pas été les causes de la renonciation mais plutôt l’effroi avant le grand saut dans l’inconnu et l’apothéose finale. Il se rappelle ce que lui avait dit Samy, son cothurne lorsqu’il était étudiant en mathématiques, sur le danger d’approcher de trop près la vérité sous sa forme absolue. Cela expliquerait pourquoi Pascal et Newton avaient abandonné les mathématiques pour la théologie
*
* *
Peut-être finalement est-ce à la philosophie de reformuler les données du problème. Pour Kant, la connaissance suppose à la fois l’intuition et le concept. L’intuition, au sens où il l’entend, se produit lorsqu’un objet s’inscrit dans les limites de l’expérience telles qu’elles sont cadrées par l’espace et le temps. Mais cela ne suffit pas : il faut appliquer à cet objet un concept qui permette de le comprendre : « un concept sans intuition est un concept vide, une intuition sans concept est une intuition aveugle ».
Tout le problème maintenant est de savoir dans quelle mesure ces définitions s’appliquent aux objets mathématiques. Beaucoup de ceux-ci s’inscrivent bien dans les cadres de l’intuition tels qu’ils sont énoncés par Kant (je peux me figurer un triangle et le tracer), mais certains leur échappent. Ce sont des objets transcendants dans la mesure où ils sont infinis. Le génie mathématique a su domestiquer l’infini en le représentant par un symbole commode (∞) ; mais une chose est de poser cet objet et une autre de l’explorer. Certes il arrive que certaines fulgurances de l’esprit soient d’authentiques épiphanies d’où jaillissent théorèmes et formules, avec une mise en présence de l’immédiat sans passer par les intermédiaires (c’était le cas pour Ramanujan), mais saisir l’infini dans sa globalité comme une totalité analytique est chose impossible.
Le grand mérite de Kant est de nous avoir invités à bien distinguer bornes et limites. La science progresse et repoussera sans cesse les bornes de la connaissance (on connaîtra toujours plus de nombres premiers et de décimales du nombre π), mais il y a des domaines où l’homme restera à jamais limité car ils sont au-delà de son expérience sensible. Aucun savant n’apportera jamais la preuve de l’existence de Dieu. Dieu peut être objet de pensée, de croyance mais pas de connaissance. Pour autant, je peux m’en faire une idée utile pour la morale, exactement comme les mathématiciens peuvent se faire une idée utile de l’infini à travers des conjectures. Tout le mystère de Petros Papachristos est là : son esprit arrive aux confins des bornes et des limites. La philosophie kantienne trace une ligne de démarcation entre les deux et nous invite à la respecter ; mais cette sagesse s’accommode-t-elle de la nature de l’homme, de son hybris (à l’instar de Petros où se mêlent passion de connaître et désir de gloire), mais aussi hélas de son obscurantisme qui veut nous faire prendre une croyance pour une connaissance, ou plus insidieusement de ses idéologies qui, en cherchant à se faite labelliser par la science, prétendent à ce qu’on les prenne pour des vérités ?
Louis Dizier
P.S Il faut distinguer conjecture de Goldbach faible ( tout nombre impair supérieur ou égal à 5 peut s’écrire comme la somme de trois nombres premiers) et conjecture de Golbach forte (tout nombre pair s’écrit comme somme de deux nombres premiers) qui implique la conjecture faible. En revanche, la conjecture faible n’implique pas la conjecture forte. La preuve de la conjecture faible a été achevée en 2013 par le mathématicien péruvien Harald Helfgott (à l’époque à l’ENS Ulm). Son article n’a pas encore été accepté pour publication dans une revue, mais beaucoup de mathématiciens pensent que sa preuve est correcte.
